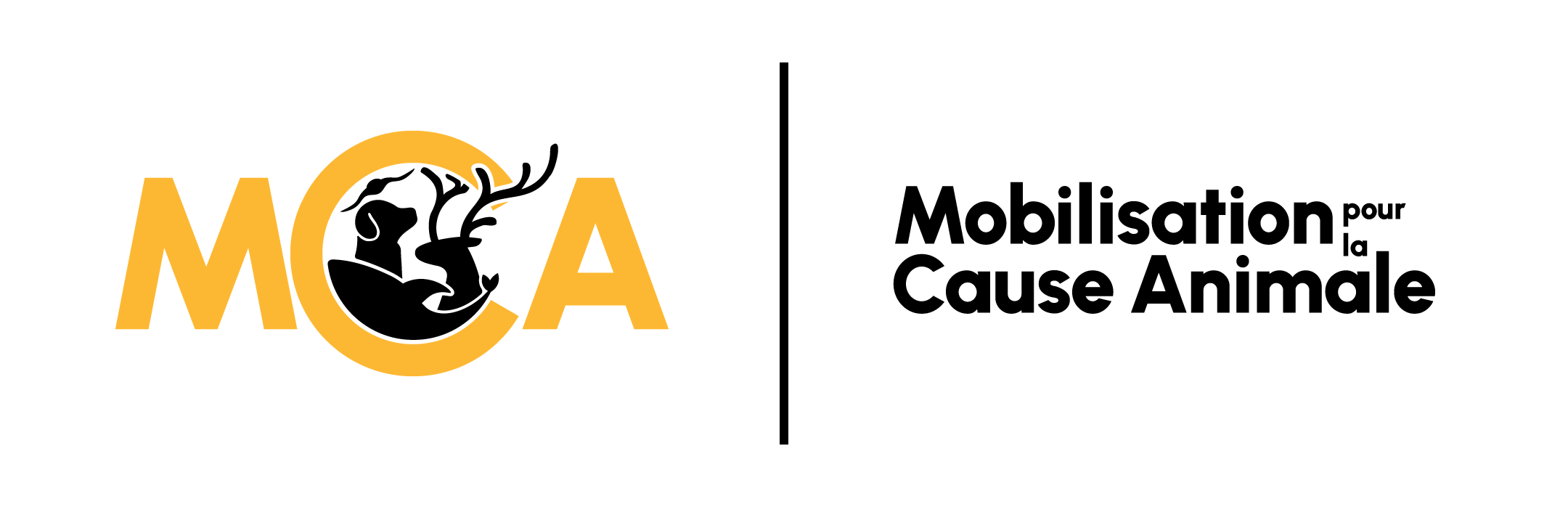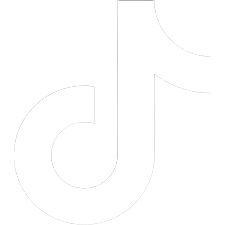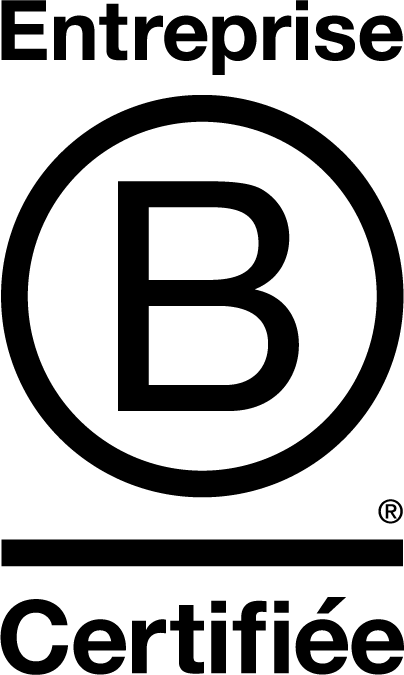A cause des pesticides, nos abeilles meurent, les moineaux et hirondelles disparaissent car les pesticides tuent les insectes !Nous voulons revenir à une vie saine, refusons en masse l'utilisation de ces pesticides mortels pour nous, car la planète entière est à l'agonie. Des enfants naissent sans bras, sans mains!
Fraises, salades, pommes, vignes, champs de blé dur ou d’orge d’hiver… l’agriculture est friande des molécules SDHI, qui visent à détruire champignons et moisissures. Un collectif de scientifiques s’inquiète des risques de ces fongicides sur la santé des organismes vivants, dont les humains. L’agence sanitaire française ne partage pas leur avis.
Un fongicide très utilisé dans l’agriculture, le SDHI, est au cœur d’un débat entre chercheurs et experts règlementaires. Derrière ce sigle obscur se cachent des molécules dont l’action est d’inhiber l’activité de la succinate déshydrogénase (SDH), une enzyme qui participe à la chaîne respiratoire. Les fongicides SDHI visent à détruire les champignons et les moisissures qui se développent dans les cultures en bloquant leur respiration. Le problème, selon plusieurs chercheurs, est qu’ils peuvent aussi bloquer celle de tous les êtres vivants, plantes, animaux, et hommes.
« Ces molécules étant décrites comme des fongicides, nous pensions qu’elles ne ciblaient que les champignons. Mais les tests que nous avons menés en laboratoire ont montré qu’elles tuaient aussi l’enzyme humaine, celle de l’abeille ou du ver de terre »,résume Pierre Rustin, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et spécialiste des maladies mitochondriales (maladies liées notamment au mauvais fonctionnement de cette enzyme). Or, le blocage de cette enzyme peut entraîner des anomalies épigénétiques, expliquant l’apparition de tumeurs et de cancers.
« À l’heure actuelle, rien ne permet de conforter le fait qu’il y ait une alerte »
Les molécules SDHI ont été développées il y a une quarantaine d’années, mais des fongicides plus puissants et à spectre plus large ont été lancés dans les années 2000. Onze substances actives de cette famille entrent aujourd’hui dans la composition de produits phytopharmaceutiques autorisés en France. Le boscalid, issu de la recherche du groupe chimique allemand BASF et autorisé dans l’Union européenne depuis 2008, est le plus vendu dans notre pays.
Selon les chercheurs, « près de 70 % des surfaces de blé tendre et de 80 % de celles d’orge d’hiver sont traitées par les SDHI », qui sont aussi utilisés sur les fraises, les salades, les pommes, dans les vignes, etc. Résultat, le boscalid est le résidu de pesticides le plus fréquemment retrouvé dans les aliments au niveau européen, selon une analyse menée en 2016 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
En avril 2018, un collectif de chercheurs, cancérologues, médecins, et toxicologues, du CNRS, de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et de différentes universités ont publié une tribune dans le journal Libération. Ils y exprimaient leur inquiétude à l’égard des fongicides SDHI et des effets délétères qu’ils pourraient avoir sur l’environnement et la santé humaine. Cela a conduit l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) à monter un groupe d’expertise afin de « déterminer si les informations et hypothèses scientifiques mentionnées par les auteurs [de la tribune] apportaient des éléments en faveur d’une exposition et de risques ». Mi-janvier 2019, elle a conclu à l’absence d’alerte sanitaire.
« Nous avons épluché toute la littérature scientifique, nous avons été en contact avec différents organismes, comme le National Toxicology Program [un programme gouvernemental de recherche étasunien en toxicologie] ou le Centre international de recherche sur le cancer [le Circ, une agence intergouvernementale créée en 1965 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des Nations unies], et aucun signal d’alerte n’est provenu de ces différentes sources », dit à Reporterre Gérard Lasfargues, directeur général délégué du pôle sciences pour l’expertise à l’Anses. « Nous ne disons pas que les questions posées par les scientifiques ne sont pas pertinentes et qu’il n’y a pas d’hypothèses à considérer, mais à l’heure actuelle, rien ne permet de conforter le fait qu’il y ait une alerte qui conduirait à retirer ces produits du marché. » L’agence reconnait toutefois les limites de l’expertise. « Il n’est pas possible de répondre de manière définitive à toutes les questions et hypothèses identifiées auprès des chercheurs lanceurs de l’alerte »
 Avis et rapport de l’Anses sur les SDHI, 15 janvier 2019.
Avis et rapport de l’Anses sur les SDHI, 15 janvier 2019.
Selon le collectif de chercheurs signataires de la tribune dans Libération, les tests règlementaires qui permettent d’évaluer les risques potentiels d’une substance ne sont pas pertinents pour cette famille de fongicides. L’un d’eux consiste par exemple à administrer des doses toxiques à un animal pendant toute la durée de sa vie pour détecter des cancers imputables à une altération de la fonction SDH. « Les rongeurs sont de très mauvais modèles pour étudier les maladies mitochondriales et les cancers qui pourraient être liés à cette substance », explique Pierre Rustin, du CNRS, s’appuyant sur les travaux publiés par certains membres du collectif.
Des taux « hallucinants » de boscalid détectés et quantifiés
Un autre test consiste à voir si la molécule induit des mutations de l’ADN et est cancérogène. « Une perte d’activité de la succinate déshydrogénase chez l’homme n’induit pas de mutation dans les gènes, mais un changement épigénétique, c’est-à-dire dans l’environnement des gènes, explique M. Rustin. À l’heure actuelle, lorsque l’on teste des molécules, on ne sait pas si elles ont un effet sur l’épigénétique cellulaire. Or, l’épigénétique cellulaire est le mécanisme par lequel arrivent les cancers chez l’homme. En réalité, on ne peut donc rien dire de la cancérogénicité de ces molécules. »
Certaines études européennes de plusieurs substances actives SDHI ont tout de même rapporté des effets cancérogènes chez les rats ou les souris. « L’évaluation des dossiers en vue de leur homologation a considéré que ces cancers ne relevaient pas d’un mécanisme transposable à l’homme », écrit l’Anses dans son rapport. Mais pour le collectif de chercheurs, ces cancers induits chez les rongeurs contredisent l’un des arguments que brandit la firme BASF (qui est également avancé dans le rapport de l’Anses) : dans un communiqué publié sur son site, le groupe allemand explique que « dans le cas où ils seraient absorbés par l’organisme, les produits de cette famille de fongicides se dégradent largement chez les mammifères et sont rapidement éliminés ». Le fait qu’ils causent des tumeurs chez les rats laisse penser qu’ils ne se dégradent pas si « largement » et qu’ils ne sont pas assez « rapidement éliminés ».
Des rampes de pulvérisateur pour la vigne.
En avril 2019, le collectif Info Médoc Pesticides et l’association Éva pour la vie ont publié les résultats d’analyses de mèches de cheveux qu’ils ont réalisés sur des riverains et des travailleurs des vignes du Médoc. Sur ces derniers, des taux « hallucinants » de boscalid ont été détectés et quantifiés. Selon Michel Urtizberea, toxicologue responsable de l’homologation chez BASF, « présence ne veut pas dire risque ». « Des doses ont été établies comme étant toxiques ou non, mais cette échelle est tout à fait discutable lorsque l’on connait les mécanismes d’actions de ces molécules et l’évolution lente des maladies qu’elles pourraient entraîner, répond Pierre Rustin, du CNRS. Ce qui importe n’est pas seulement la dose, mais aussi le moment et le temps d’exposition. »
« Ce n’est pas l’agence qui est en cause, mais la manière dont sont établis les tests de toxicité »
Avant de pouvoir être mis sur le marché, les produits phytopharmaceutiques doivent être évalués au niveau européen. Mais la différence d’objectifs entre la recherche fondamentale et la recherche règlementaire, qui consiste à répondre à des critères bien précis, ne laisse-t-elle pas des angles morts ? « Nous savons tous parfaitement que l’évaluation règlementaire des substances ne règle pas tout, dit Gérard Lasfargues, de l’Anses. Il y a des points à améliorer, en particulier la question de l’exposition cumulée, c’est-à-dire le fait d’avoir affaire à des mélanges de substances. »
Face aux doutes persistants, le collectif de scientifiques reproche à l’Anses de ne pas appliquer le principe de précaution. L’agence, elle, affirme l’avoir appliqué à la lettre. « Si vous lisez la Constitution et la règlementation européenne, il est écrit qu’en cas de doute ou d’incertitudes, il faut évaluer les risques, rappelle M. Lasfargues. C’est exactement ce que nous avons fait ! À la question “y a-t-il un risque lié à l’exposition de ces substances ?”, aujourd’hui, la réponse est non. Nous n’avons pas les arguments sur le plan règlementaire pour retirer ces substances du marché. »
À plusieurs reprises, des produits autorisés par l’Anses ont finalement été retirés du marché à la suite de décisions de tribunaux administratifs qui invoquaient ce « principe de précaution ». En novembre 2017, le tribunal de Nice a suspendu l’autorisation de deux formulations à base de sulfoxaflor, l’insecticide « tueur d’abeilles ». En janvier 2019, c’est l’herbicide Roundup Pro 360 qui était retiré du marché, à la suite d’une décision du tribunal de Lyon.
François Dedieu est chercheur en sociologie à l’Inra. Ses travaux portent notamment sur la gouvernance des risques collectifs associés à l’usage des pesticides. « Ce n’est pas l’agence qui est en cause, mais la manière dont sont établis les tests de toxicité, dit-il. Ces tests sont certes de plus en plus rigoureux, mais ils ont une vision très standardisée des dangers qu’ils doivent évaluer et écrasent souvent une grande partie des données. » François Veillerette, directeur de Générations futures, va dans le même sens : selon lui, « le cadre réglementaire favorise une évaluation partielle ».
« Contrairement à d’autres pesticides, dont les mécanismes d’action sont encore flous, nous savons parfaitement ce que ciblent les SDHI. Cette cible est présente chez tous les mammifères et tous les organismes vivants. Et tous sont tués par les SDHI s’ils y sont exposés suffisamment longtemps ou en quantité, constate Pierre Rustin, du CNRS. Ne pas retirer ce produit du marché est totalement irresponsable ! » L’Anses a annoncé ne pas clore le dossier.